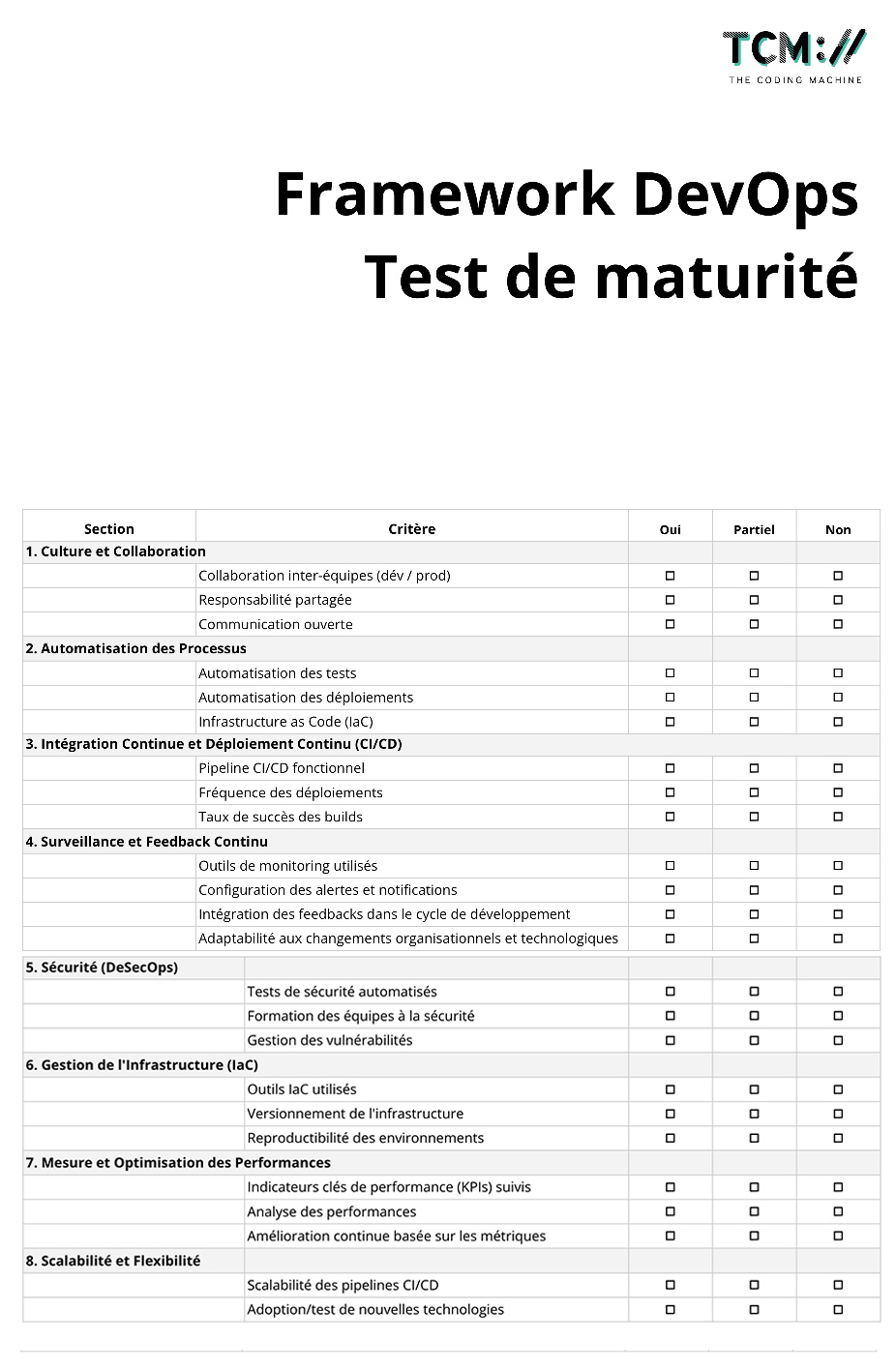Le diagnostic est sans appel, votre projet est planté. Pas de panique, TheCodingMachine vous apporte des solutions !
Poser le bon diagnostic résout une grande partie du problème, car une fois que les problèmes sont identifiés, il est possible de mettre en place un plan d’actions efficace.
Pour garantir un résultat fiable et sérieux, solliciter une société extérieure reste, à notre avis, la meilleure option (si vous choisissez cette solution, n’hésitez pas à nous appeler). Car la toute première étape consiste à se débarrasser des problèmes périphériques qui accompagnent inévitablement la dérive d’un projet et parasitent notre vision. Faire appel à un tiers qui est indépendant et sans a priori permet de dépassionner le débat.
L’importance du contexte
Réussir le sauvetage d’un projet nécessite de plonger au cœur du problème afin de dresser un tableau objectif de l’état du projet. Quels sont les problèmes ? Peuvent-ils être résolus rapidement ? Par qui et de quelle manière ?
Les solutions dépendent étroitement de l’état du projet : le projet est-il encore en développement ou bien en production. Elles dépendent aussi de la nature des problèmes : est-ce un problème technique ? Un problème concernant le périmètre ? Ces solutions dépendent évidemment de la taille du projet. Plus un projet est petit, plus il est simple de le reprendre depuis le début.
Un bon conseil : ne pas avoir peur … de supprimer le problème
Si les problèmes ont une origine technique, l’application développée a peu de chance d’être « sauvée ». Corriger des erreurs graves de conception de l’architecture est souvent très coûteux. A budget équivalent, il vaut mieux reprendre les développements techniques « from scratch ». L’analyse de l’existant doit donc être méticuleuse pour éviter de jeter une application qui pourrait être sauvée, mais également pour ne pas vouloir sauver cette application à tout prix et faire durer l’échec.